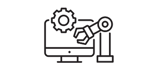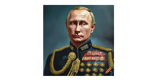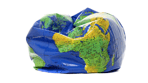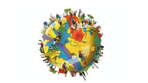François de Navarre
Et moi, et moi, et moi.


Pau, le 10 février 2024. Ah, Bayrou ! S’il en est un qui croit encore à son destin, c’est bien lui. Il l’a su très vite, il en a parlé très tôt, c’est son orient, sa boussole : il sera président. Comment lire autrement le coup d’éclat de cette semaine ?
Bayrou, nous le suivons depuis longtemps, avec un étonnement qui se renouvelle d’année en année. Quelle persévérance ! En cela il marche bien dans les pas d’un Mitterrand ou d’un Chirac, tout entiers tendus, pendant des décennies, vers le Graal de l’Élysée, et convaincus qu’ils y sont appelés par le destin. Voire, dans le cas de Bayrou qui aime citer Bossuet, par la Providence.
Mais une chose est de se voir comme l’oint du Seigneur, et une autre d’être élu. En 2007, il n’était pas passé très loin du deuxième tour, où il avait ses chances. En 2017, il avait joué les faiseurs de roi. Il se met aujourd’hui en situation d’être l’homme providentiel face à Marine Le Pen.
Un « sauveur », dans la grande tradition française ? Mais aussi un traître, car c’est un marqueur anthropologique des présidents de la Ve République, que d’assumer une rupture inopinée avec des alliés.
Giscard avec les gaullistes, Mitterrand avec Deferre, Chirac avec Giscard, Sarkozy avec Chirac, Hollande avec personne (ne serait-ce pas une partie de son problème ?), Macron avec Hollande. Et désormais Bayrou avec Macron.
Cette figure de la traîtrise leur colle à la peau, mais elle les qualifie politiquement. Marianne préfère Don Juan au Commandeur. La Cinquième est le royaume de Machiavel, pas de Thomas d’Aquin.
Le problème de Bayrou, c’est que ses traîtrises sont plutôt des dérobades. Un peu comme Chevènement démissionnait, il a l’habitude de refuser d’entrer dans le jeu. Aujourd’hui la fin de mandat aujourd’hui (plutôt conserver sa virginité pour 2027) ; hier l’alliance avec Ségolène Royal refusée alors qu’elle lui ouvrait les portes de Matignon.
Matignon ? Tout à perdre, quand on vise l’Élysée. Alors pensez, l’Éducation nationale…
Au contraire il a tout à gagner à ramasser les morceaux dans trois ans. Sa tactique, Richard Robert en faisait l’analyse dès le 27 avril 2007, entre les deux tours. Même si l’équation politique a changé, les mouvements sont les mêmes aujourd’hui – fondamentalement, faire une OPA sur un segment électoral en déshérence, et sur une structure partisane affaiblie :
« En annonçant la création d'un Parti démocrate dont l'ambition explicite est de mordre sur l'électorat socialiste, le président de l'UDF affiche ses ambitions : devenir le futur chef de l'opposition en tablant sur l'incapacité du PS à se réformer. Y parviendra-t-il ? Pour Bayrou il ne s’agit pas seulement de relancer une dynamique de campagne qui pourrait s’épuiser, mais de prendre pied sur un espace politique, le centre gauche, fragilisé sur le plan électoral et dont l’encadrement donne des signes de faiblesse ou d’impatience. Le PS reste un parti d’élus, qui par-delà les divisions et les rancunes ont besoin de faire durer la maison bâtie à Épinay pour assurer leur réélection. Il n’en reste pas moins que ses murs sont fragiles, et Bayrou l’a compris. Ce n’est pas sans arrière-pensées qu’il a commencé à se rapprocher des électeurs, puis des élus socialistes. » (« Bayrou, l’opposition ce sera moi ! »)
Bref : la campagne a commencé. Et le monde d’après ressemble fort au monde d’avant.
Et sur Telos cette semaine ?
Le 9 février, Charles Wyplosz mettait les points sur les i en revenant sur les politiques économiques suivies pour traiter la question climatique : « La crise agricole épingle la fausse route de la lutte contre le réchauffement climatique »
C’est peut-être prétentieux de l’affirmer, mais il y a une règle immuable en démocratie : à trop secouer les principes économiques, les choix politiques finissent toujours mal. Ce peut être un échec coûteux, une remise en cause plus ou moins discrète, ou des conséquences électorales sévères. La crise agricole révèle les sérieuses dérives de la lutte contre le réchauffement climatique.
Le 8 février, Gilles Andréani donnait une analyse remettant en perspective (au double plan stratégique et politique) le débat tronqué sur les négociations qui pourraient mettre fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine : « Ukraine : vaincre ou négocier, un faux dilemme »
Depuis que l’offensive ukrainienne de l’été s’est enlisée, deux thèmes majeurs dominent le débat sur la guerre en Ukraine : « l’Ukraine ne peut pas gagner » et « puisqu’il en est ainsi, elle doit négocier ». Sous l’apparence du bon sens, ces deux propositions sont fallacieuses. Elles servent les Russes, qui les entretiennent soigneusement, et elles sont erronées sur le plan stratégique. Il faut, pour s’en convaincre, revenir aux données fondamentales de la guerre d’Ukraine.
Le 7 février, Laurent Célérier donnait une analyse précise de la situation en mer Rouge avec les attaques des Houthis : « La mer Rouge, artère maritime de l’Europe: de la piraterie à la guerre navale? »
Alors que les sujets maritimes sont souvent éloignés des préoccupations de nos concitoyens et des médias, la situation en mer Rouge rappelle les risques pesant sur la liberté de navigation. Quelles sont les forces en présence, et comment répondre à la menace ?
Et puis nos deux sociologues préférés reviennent sur deux des thèmes abordés par le président de la République dans sa conférence du 16 janvier. Monique Dagnaud, le 6 février : « Jeunesse : scroller ou l’art de la fuite (des cerveaux) »
Lors de son intervention télévisée du 16 janvier, Emmanuel Macron a annoncé avoir confié à un groupe d’experts une analyse sur les pratiques d’écrans. Cette initiative est-elle vraiment utile, quand tant de diagnostics ont déjà été établis au cours des quinze dernières années ? Le seul sujet qui vaille est celui du contrôle des usages, en particulier à l’école, un point crucial pour l’avenir de nos sociétés, et sur lequel la plupart des États occidentaux ont révélé jusqu’ici leurs comportements erratiques et leur impuissance.
Et Olivier Galland, le 5 février : « Emmanuel Macron et la jeunesse: un tournant autoritaire trop sommaire »
Dans sa conférence de presse du 16 janvier, le Président de la République a mis à l’honneur le retour de l’autorité et la jeunesse, associant l’un à l’autre. Mais la jeunesse a-t-elle seulement ou même principalement besoin d’un rappel à l’ordre ? Essayons d’y voir plus clair.
...