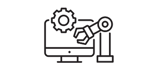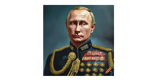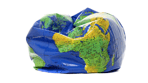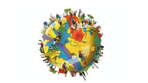Le Janus européen
Monnet et Spinelli sont dans un bateau.


Bruxelles, 16 décembre 2024. L’impossible M. Orbán a encore frappé. La Hongrie a réussi à bloquer un nouveau volet d’aide européenne à l’Ukraine. Mais elle a dû céder sur l’ouverture officielle des négociations d’adhésion pour l’Ukraine et la Moldavie.
Il y a deux questions dans cette séquence. (Il y a en a mille, mais c’est le privilège de l’éditorialiste de simplifier le réel. Donc, deux.)
La première : que veut le Premier ministre hongrois ? Personne ne sait faire la part entre un agenda ouvertement pro-russe et les intérêts de Budapest qui, comme Vienne, sa jumelle kakanienne, a fait de l’équilibrisme une des conditions de son existence. L’Est pour résister à l’Ouest, et vice versa.
Tout ce qu’on sait, c’est qu’une sortie de l’UE n’est pas à l’ordre du jour. Caroline de Gruyter l’expliquait le 7 décembre sur Telos (« Que veut Geert Wilders en Europe ? »), en décryptant un discours prononcé à Zürich. « Orbán a expliqué à son public suisse que les décisions prises à Bruxelles affectent directement la Suisse en tant que participante au marché unique, sans que Berne n’ait son mot à dire sur ces décisions. Raison de plus pour rester et façonner ces décisions de l’intérieur. »
Bref : fini les Xit. Bonjour les ennuis. Une bonne nouvelle, une mauvaise. Mais c’est le style européen, n’est-ce pas ?
Cela nous amène à la deuxième question. L’Europe puissance s’affirme-t-elle ? Ou au contraire fait-elle la preuve de son impossibilité ?
Les fédéralistes, comme Jacques Fayette sur Telos, ont pris l’habitude de se désoler. « En 1957, Altiero Spinelli affirmait dans le Manifeste des Fédéralistes européens que, faute de solution fédérale, nous n’avions qu’à attendre l’accomplissement de notre destin. Son affirmation est encore plus vraie aujourd’hui. » (« Le fédéralisme à l’envers », 4 novembre 2023)
Mais la leçon de 2023 est différente. Le fondateur de Telos, Zaki Laïdi, est aujourd’hui conseiller spécial du Haut Représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell. Dans un entretien avec Sylvain Kahn à Sciences Po, il expliquait en septembre comment la crise ukrainienne avait précipité « le réveil géopolitique de l’Europe ».
« Ce sont les événements qui ont façonné le changement, confortant ainsi la prophétie de Jean Monnet pour qui l’Europe ne pourra se faire qu’au travers d’enjeux concrets et à la faveur de crises. C’est exactement ce qui s’est produit. La crise ukrainienne consacre le triomphe non pas de l’Europe fédéraliste, mais de l’Europe fonctionnaliste. À Bruxelles, si vous lancez un débat sur des bases conceptuelles ou stratosphériques, vous vous exposez à d’inévitables déconvenues. »
Sur Telos, nous sommes plutôt en ligne avec cette analyse. M. Orbán est compliqué à gérer, mais il restera à bord. L’Europe est engagée sur le chemin de la puissance, car les souverainistes ont compris que sans l’UE leurs pays ne sont même plus sur la carte.
Dans un article de mars 2022, Elie Cohen et Richard Robert expliquaient comment les crises font avancer l’Europe, de plus en plus vite, sur le mode d’une valse à trois temps : une mauvaise réaction initiale, une correction décisive qui change les règles, une législation qui entérine cette nouveauté. « Au sortir de la crise de l’euro, le sentiment qui dominait, à côté d’un évident soulagement, était le découragement : l’Union était décidément un paquebot bien lent, qui avait bien du mal à changer de cap. Il fallait beaucoup de foi pour parier sur elle, et elle n’était pas faite pour naviguer à vue, ni par gros temps. Heureusement, une crise comme celle de l’euro ne se produisait pas tous les quatre matins. Or au fil des années qui suivirent d’autres crises survinrent, certaines tout aussi graves, et à chaque crise on constata ceci : la valse à trois temps était bien là, mais son tempo s’accélérait. » (« Europe : naissance d’une puissance », 4 mars 2022)
De puissance, on parlait aussi cette semaine sur Telos à propos de la Russie, avec en entrée une passionnante analyse de Bernard Chappedelaine, le 11 décembre :
Au cœur de l’idéologie poutinienne, « l’État-civilisation »
Concept aux usages multiples, « l’État-civilisation » légitime le comportement impérial de Moscou, la confrontation avec l’Occident et la formation d’un monde multipolaire. Cette notion permet de dépasser une vision ethnique de la Russie, mais elle justifie aussi la criminalisation de la mouvance libérale. La négation de l’identité ukrainienne et des tensions communautaires en Russie, l’attribution à un Occident jugé en déclin de la responsabilité de tous les conflits de la planète peuvent toutefois être source de déconvenues pour le Kremlin.
Le 12 décembre, Gérard Grunberg croisait le fer avec Nonna Mayer et Vincent Tiberj sur leur analyse quelque peu lénifiante du nouvel antisémitisme.
Le « nouvel antisémitisme » existe-t-il ?
Le 33e rapport de la CNCDH fournit de nombreuses données sur les attitudes des Français à l’égard des juifs et d’Israël. L’une des questions abordées est l’existence d’un nouvel antisémitisme chassant l’ancien et passé de l’extrême droite à l’extrême gauche du champ politique. Sur ce point les conclusions du rapport méritent discussion.
Le 13 décembre, alors que certains membres du comité éditorial de Telos étaient à la piscine, le rocardien Jean-François Merle s’étonnait de l’étrange coalition qui avait rejeté la loi immigration. Et posait aux oppositions unies dans la passion de s’opposer la question, un tantinet négligée par icelles, de l’intérêt électoral de leurs contorsions.
Qui voudrait être gouverné par une « majorité Pierre Dac » ?
« Contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est contre »... Le plus dérisoire, dans la motion de rejet qui l’a emporté hier, est que cela se fait au nom du respect des droits du Parlement, y compris de la part de députés qui revendiquent une République plus parlementaire que le régime actuel. Mais comment cette République pourrait-elle fonctionner alors qu’ils témoignent d’un refus absolu de toute position de compromis ?
Le 14 décembre, Monique Dagnaud faisait la preuve magistrale qu’elle n’était pas, le 13, à la piscine, mais très occupée à peaufiner un article analysant des discussions avec des jeunes en juillet dernier.
Regards de la jeunesse des cités sur les violences urbaines
Du 27 juin au 7 juillet 2023, des violences urbaines se déroulent dans plusieurs communes françaises. Simultanément a lieu à Paris une expérience de démocratie participative organisée par l’ONG Ashoka, avec majoritairement des jeunes et quelques adultes, en présence de chercheurs. Saisissant à la volée un « moment sociologique », on leur propose de s’exprimer sur les événements en cours. Qu’en ressort-il ?
Le 15 enfin, Antoine de Tarlé revenait sur la crise de l’information (il prépare un livre sur ce sujet), en posant la question angoissante de sa volatilisation façon puzzle dans le maelström des plateformes.
L’information numérique : métamorphose ou disparition
Le quotidien La Croix et le cabinet Kantar procèdent chaque année à une vaste enquête sur l’usage et la confiance dans les médias. Les résultats publiés le 25 novembre dernier illustrent une évolution très préoccupante : l’univers numérique de plus en plus vaste et divers laisse une place réduite à l’information que le public, désorienté et saturé, tend à délaisser, quitte à se contenter de messages biaisés et toxiques échappant à toute forme de modération et éparpillés dans les plateformes les plus diverses.
On vous laisse retourner sur Tik Tok ou filer à la piscine. Bonne semaine !
...