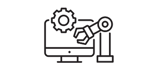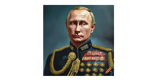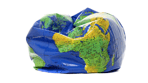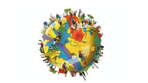L’illusion allemande
Fin de partie ?


Stuttgart, le 20 janvier 2024. Comme on le craignait, l'économie allemande est bien entrée en récession en 2023, avec une chute de 0,3% du PIB, a indiqué lundi l'institut Destatis. Après vingt-cinq ans de succès ininterrompus, les signaux économiques passent au rouge les uns après les autres. Que se passe-t-il ? Reviendrait-on aux années 1990 et à l’homme malade de l’Europe ?
Il y a deux façons de lire les mauvaises performances de l’économie allemande. La première est la tempête parfaite.
Prenez un pays dont l’économie est centrée sur l’industrie, et dont l’industrie est centrée sur l’automobile ; un pays très intégré commercialement à la Chine et aux États-Unis ; et un pays dont les industries énergo-intensives s’appuient principalement sur le gaz russe.
Ajoutez le Covid qui engorge les chaînes d’approvisionnement, la guerre en Ukraine qui coupe le gaz, et la nouvelle politique industrielle américaine qui rapatrie la production dans l’Alabama.
Mélangez.
Introduisez, pour épicer le tout, la révolution de la voiture électrique, qui fait apparaître des concurrents venus de nulle part (Tesla, les Chinois) et anéantit la différenciation industrielle allemande.
Le choc est rude ! Et le contre-choc aussi : Carlo Altomonte et Martina di Sano montraient ainsi dans un article de Telos le 25 novembre 2022 comment le renchérissement du gaz russe amenait les géants allemands, dans la chimie notamment (mais aussi l’automobile et les machines-outils), à un report de charge sur leurs usines chinoises. D’où une attrition de la production nationale – et une dépendance accrue envers la Chine, qui finit par poser un problème géopolitique : le voyage du chancelier Scholz à Beijing, le 4 novembre 2022, a modérément plu à ses partenaires occidentaux (Cyrille Bret, « Scholz en Chine : un procès en sorcellerie géopolitique ? », 16 novembre 2022).
Cela nous amène à la deuxième lecture, qui complète la première. Le premier à l’avoir proposée est l’économiste Marcel Fratzscher dans un livre paru en 2014, Die Deutschland-Illusion: Warum wir unsere Wirtschaft überschätzen und Europa brauchen (Hanser, Munich). Il expliquait qu’en réalisant une forme d’intégration parfaite à l’économie mondiale, l’Allemagne avait négligé l’ancrage européen qui avait permis son essor.
Notre ami Élie Cohen avait fait une note de lecture détaillée de l’édition anglaise de 2018, The Germany Illusion. Il écrivait notamment :
« Comme le rappelle Fratzscher, l’Allemagne a incontestablement bénéficié de l’intégration européenne, au plan commercial, avec l’institution du marché unique puis avec l’élargissement et enfin l’adoption de l’euro. Disposer d’un marché unifié et régulé de 550 millions de consommateurs lorsqu’on est une puissance manufacturière et que les effets d’agglomération et de polarisation jouent en votre faveur est un immense avantage. Disposer à vos portes d’un hinterland industriel pacifié et développé grâce aux fonds communautaires est un autre avantage majeur. Offrir à son Mittelstand un vaste espace d’expansion sans risque de change est un autre atout. L’Europe unie est à la fois une base domestique puissante et un formidable tremplin pour la conquête des marchés extérieurs. L’extraversion de l’économie allemande s’est faite à partir de l’Europe, grâce au multiplicateur de puissance européen. C’est l’Europe qui négocie les accords commerciaux à l’OMC et ailleurs. Si l’Allemagne est une puissance industrielle majeure son poids est accru par l’Europe et sa voix porte ainsi plus loin. » (Élie Cohen, « La nouvelle question allemande », Telos, 12 mars 2019)
C’est une des leçons de cette étrange décennie dans laquelle le monde change à toute vitesse.
Nous finirons ce billet sur un satisfecit : vous l’aurez peut-être noté, nous n’avons pas une seule fois écrit le mot Schadenfreude dans cet article. Comme quoi c’est possible ! (Merci à notre partenaire et ami Microsoft Word pour nous avoir aidés à l’orthographier.)
Cette semaine sur Telos ? Voici notre rétrospective. À l’envers, pour une fois.
L’adhésion de la Géorgie à l’Union européenne: un Kaliningrad inversé ?
Cyrille Bret, le 19 janvier
Depuis le 14 décembre 2023, la Géorgie a officiellement reçu le statut de candidat à l’adhésion à l’Union Européenne. Cette décision peut surprendre : l’ancienne République Socialiste Soviétique est dépourvue de continuité territoriale avec l’Union. Les Géorgiens sont-ils des Européens situés hors de l’Europe géographique et historique ? L’Europe aura-t-elle bientôt une «exclave» insérée dans l’espace russe, tout comme la Russie utilise celle de Kaliningrad au cœur de l’Europe du Nord ?
Pierre Jaillet, le 18 janvier
Des semaines de discussions laborieuses conduite sous la présidence espagnole de l’Union européenne et reflétant les clivages habituels entre Etats « dépensiers » et «frugaux» ont abouti à un compromis sur la réforme du Pacte de stabilité et de croissance suspendu depuis 2020. Le règlement du Conseil, après avis du Parlement européen, doit entrer en vigueur en 2024. Quel jugement peut-on porter sur ce nouveau cadre budgétaire, qui constitue un enjeu crucial pour la bonne marche de l’Union économique et monétaire ?
De l’immigration à l’intégration
Dominique Schnapper, le 17 janvier
Le débat sur l’immigration ne saurait évacuer l’interrogation essentielle sur la capacité d’intégration de la société actuelle. Même s’il importe de ne pas négliger les caractéristiques des populations elles-mêmes, les difficultés et les contradictions objectives de leur condition, sans oublier leur volonté et leur capacité d’action, il faut souligner que le « problème des immigrés » est aussi, peut-être avant tout, un problème de la société elle-même.
Fiscalité du capital : une singularité française confirmée
Gilbert Cette et Élie Cohen, le 16 janvier
Année après année l’interrogation persiste et, comme le montre le dernier rapport de France Stratégie, la réponse ne varie guère : oui, depuis le tournant de l’économie de l’offre, la France fait des efforts pour rapprocher sa fiscalité du capital de celle de ses principaux concurrents et partenaires. Mais non, la différence subsiste et avec elle les questionnements sur l’attractivité française et les handicaps structurels à la croissance et à l’emploi.
La valeur travail décline-t-elle ?
Olivier Galland, le 15 janvier
Depuis quelques mois, le thème de la « grande démission » a fait son apparition dans le débat public. Le taux de démission augmenterait, révélant ainsi la distance grandissante prise à l’égard du travail par les salariés. À diverses occasions, des étudiants de Grandes Écoles ont également remis en cause le destin professionnel que paraissait leur promettre le parcours au sein de l’élite scolaire. Quelques sondages récents ont semblé confirmer ce recul de la valeur travail. Qu’en est-il réellement ?
...