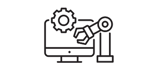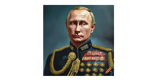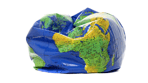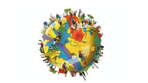Gilets verts et verts galants
Une petite musique française.


Agen, le 27 janvier 2024. Cela faisait un petit moment qu’on sentait monter le sujet. La colère des agriculteurs, ces derniers mois, a pris un tour politique chez un certain nombre de nos voisins. Aux Pays-Bas, le Mouvement agriculteur citoyen est arrivé en tête aux sénatoriales du printemps 2023 (18%), dans la foulée des manifestations contre le « plan azote » qui prévoit une réduction drastique des intrants. En Allemagne, un mouvement social a commencé en décembre contre la réforme de la fiscalité du diesel agricole décidée par le gouvernement d’Olaf Scholz.
Les revendications sont multiples. En vrac : les contraintes de la transition environnementale, la surréglementation et la bureaucratie, les choix publics en faveur de l’industrie agroalimentaire et incidemment des consommateurs.
Bref, comme chez nous.
Mais il y a une petite musique française qui marque, comme toujours, notre singularité dans le concert européen. Tout d’abord, la colère des agriculteurs fonctionne comme un miroir. Chaque indigné, et Dieu sait combien notre pays en compte, y voit un écho de sa propre colère.
La CGT appelle à la convergence des luttes (on ne rappellera pas ici sa jonction manquée avec les gilets jaunes en 2018).
Le RN et LR soufflent sur le feu en accusant l’Europe.
Les écologistes ? Ah, ce sont les plus amusants en ce moment. Il faut les voir se contorsionner pour faire valoir leur amour des tractorist·e·s et des éleveurs de cochon·ne·s.
Tenez, même le raisonnable Yannick Jadot répétait hier que cela fait trente ans qu’il lutte contre les traités de commerce. Trente ans de lutte ! Bravo Yannick.
Chez Telos, on n’a pas la mémoire aussi longue, parce que nous sommes nés en 2005. Mais justement, les deux premiers papiers qu’on ait publiés, le 12 décembre de cette année-là, parlaient de commerce, et d’agriculture.
Dans « Hong Kong, le commerce et la morale », Lionel Fontagné rappelait qu’avec 15% de droit de douane moyen dans l’agriculture, l’Europe faisait figure de forteresse protectionniste. Jean-Christophe Bureau et Sébastien Jean lui faisaient écho dans « L’interminable ouverture des marchés agricoles ». Pour de multiples raisons, l’intégration commerciale de l’agriculture mondiale se fait au ralenti.
C’est curieux, d’ailleurs, on n’entend pas les agriculteurs allemands et néerlandais demander le démantèlement des traités.
Peut-être parce qu’ils ont gagné des parts de marché, quand nous en perdions ?
Se pourrait-il que l’ouverture commerciale ne soit pas le problème ? Que la productivité perdue des agriculteurs tienne, par exemple, à ce que la France soit le pays d’Europe qui taxe le plus les terres agricoles ? Ou aux charges sociales, avec un taux de prélèvement de 45 % des revenus professionnels des exploitants français, soit dix points de plus que leurs concurrents européens ?
On n’ose le croire.
Les problèmes des agriculteurs européens sont bien réels, et demandent à être traités à hauteur des enjeux. Mais l’Europe est exportatrice nette, les agricultures de nos voisins se sont magnifiquement développées et il n’y a guère qu’en France qu’on tape à tour de bras sur les « traités ». Nos agriculteurs ont les mêmes problèmes que leurs confrères-et-soeurs européens. Mais ils ont aussi, et avant tout, un problème majeur de productivité. Et, comme pour l’industrie, ce sont nos propres réglages socio-fiscaux qui sont en cause.
La bonne nouvelle, c’est que c’est plus facile à régler, et que le Premier ministre semble avoir pris la mesure, sinon des enjeux, en tout cas du risque politique. Les dirigeants de la majorité auraient gagné du temps en lisant ce papier d’Eddy Fougier publié le 18 mars 2022 : « Ainsi que l’affirmait François Purseigle en 2017, une élection présidentielle ne se gagne pas avec les voix des agriculteurs, mais elle peut se perdre avec les voix des agriculteurs et de leurs collatéraux ou des gens avec qui ils travaillent. Cela tend à signifier que les différents candidats ne doivent en aucun cas négliger les enjeux agricoles et alimentaires et que c’est peut-être dans les campagnes que se jouera la campagne. » (« Et si en 2022 le vote agricole était décisif ? »)
Le premier problème des agriculteurs français n’est ni au siège de l’OMC à Genève, ni à Bruxelles. Il est à Paris.
(Vous aussi, vous voulez jouer avec le point médian ? Voici comment faire. 1) Appuyez sur la touche Alt. 2) Appuyez successivement sur les touches 0, 1, 8, 3 de votre pavé numérique. 3) Relâchez la touche Alt. 4) Si vous trouvez que c’est trop compliqué ou que vous utilisez un Mac, faites comme nous : allez sur le site de l’EHESS et faites un copier-coller.)
Cette semaine sur Telos ?
Vendredi 26 janvier, un papier de Gérard Grunberg sur les élections européennes : Les Français et l’Europe cinq mois avant les élections
Alors que va débuter la campagne pour les élections européennes, le clivage politique principal dans l’électorat sur l’enjeu européen n’est ni l’opposition gauche/droite, ni l’opposition du centre contre les extrêmes mais l’opposition entre l’extrême-droite et les autres partis. Mais l’Europe elle-même ne fait plus l’objet d’un refus chez les électeurs du RN.
Le 25 janvier 2024, il y avait une note de leture de Bernard Chappedelaine sur le dernier essai de Sylvie Kauffmann : Sur un double aveuglement
Analyser «vingt ans de naïveté, de complaisance, d’arrogance parfois ou simplement de négligence» à l’égard de la Russie de Vladimir Poutine, c’est l’objet du dernier livre de Sylvie Kauffmann, riche des témoignages de nombreux acteurs de cette période, qui souligne le «poids prépondérant» de l’Allemagne et de la France dans la politique européenne à l’égard de Moscou.
Le 24 janvier, Mahnaz Shirali donnait une idée de ce qui se passe dans les écoles iraniennes : L’éducation idéologique dans les écoles de la République islamique
Depuis plus de quarante ans les élèves iraniens sont soumis à une sorte d’empoisonnement mental. Le contenu des manuels scolaires est affligeant : de la division de l’enseignement selon le sexe, jusqu’à l’incitation au suicide, en passant par l’encouragement au mariage des enfants.
Le 23 janvier, nous publiions la traduction d’un article de Ruxandra Teslo sur une évolution inquiétante de la culture des élites, à rebours de la « culture de la croissance » qui a présidé à l’essor de l’Europe il y a trois siècles : Sur la culture du pessimisme
On observe aujourd’hui un glissement, dans la pensée des élites, vers une prudence excessive, un scepticisme à l'égard de la technologie et une pensée à somme nulle. Ce phénomène est le défi idéologique majeur de notre époque.
Le 22 janvier, Yousra Abourabi, Julien Durand de Sanctis et Jean-Noël Ferrié revenaient sur les engagements militaires en Afrique subsaharienne : La France au Sahel: l’usure d’un ethos politique et militaire en Afrique
Niger, Mali: les déboires récents de la France renvoient à un problème structurel mettant en jeu l'ensemble de la relation avec les pays africains. Il s’agit de la difficulté de se représenter le point de vue africain. La question n’étant pas que ce point de vue soit le bon ou pas. Ce qui importe est la faculté d'insérer l'action publique internationale de la France dans un cadre de réciprocité des perspectives où, même si la partie française n'est pas d'accord avec ses partenaires, elle sait ce qu'ils font fait et se représente, sans trop de biais, ce qu'ils pensent de ce qu'elle fait.
...